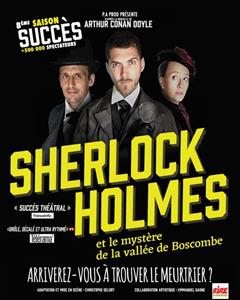Peer Gynt
Peer Gynt
- De : Henrik Ibsen
- Mise en scène : Patrick Pineau
- Avec : Bouzid Allam, Gilles Arbona, Baya Belal, Nicolas Bonnefoy, Frédéric Borie, Hervé Briaux, Jean-Michel Canonne, Laurence Cordier, Eric Elmosnino, Aline Le Berre, Laurent Manzoni, Christelle Martin, Mathias Mégard, Cendrine Orcier, Fabien Orcier, Annie Perret, Julie Pouillon, Marie Trystram, François Caron
Au début, une mère accuse son fils de mentir. A la fin, une compagne invite son compagnon à rêver. Entre ce début et cette fin, inscrite ainsi entre les marges du féminin, c’est une histoire d’homme, bien entendu, qui se déroule : une histoire qui s’appelle Peer Gynt, celle d’un homme qui s’appelle Peer Gynt. Cet homme partage avec d’autres héros de la scène Faust, Dom Juan, Baal ou Roberto Zucco le privilège de donner son nom à la pièce qui le raconte, mais surtout une sorte d’énergie théâtrale très particulière, qui donne aux textes en question une qualité pour ainsi dire sismographique.
Ecrire le théâtre paraît consister ici à enregistrer les trajectoires tremblées et pourtant si nettes de ces figures sans repos, dont la vitesse traverse le monde, ainsi qu’on le dit de Woyzeck, « comme un rasoir ouvert ». Comme elles, Peer est d’abord un sillage, capté tant bien que mal sur l’écran de l’écriture. Ce n’est pas un hasard s’il appelle «sur» une étoile filante. « Peer Gynt, sa vie, son oeuvre » ? Sans doute. Mais à condition de souligner que les trois termes sont ici plus inextricablement mêlés que jamais. Cette oeuvre-vie se laisse lire comme un mensonge énorme ou un rêve sans fin mensonge où le menteur est lui-même emporté, rêve dont le rêveur est lui-même tissé : écriture, sous nos yeux, d’une légende.
Peut-être est-ce là ce qui a fasciné Patrick Pineau. Sa première mise en scène à l’Odéon (Monsieur Armand dit Garrincha, de Serge Valletti) présentait déjà la figure d’un conteur possédé à tous les sens du terme : hanté, trompé par sa propre légende. Et c’était déjà à Eric Elmosnino, son frère en théâtre, que Pineau avait confié l’incarnation de ce vertige, avant de l’engager à ses côtés dans un premier travail d’équipe Les Barbares, de Gorki qui lui vaut aujourd’hui, sur l’invitation de Vincent Baudriller, de créer Peer Gynt dans la Cour d’Honneur du Palais des papes à Avignon.
Peer Gynt : cinq actes qui font toute une existence. A force de mentir-vrai, d’énergie et d’absence (car il en faut, et même beaucoup, puisque nul n’est prophète en son pays), à force de circuler à tous les étages de l’être, réels ou non, Peer l’exclu, le traqué, le rêveur un peu ivrogne et un peu fou, finit par se transmuer en créature quasiment mythique. Peer se raconte, se ment, se vit, se rêve c’est tout un. Et c’est ainsi, par cette voie, qu’il est ou qu’il devient celui qu’il est. Cette quête de « soi » communique à Peer et à la pièce qui porte son nom une sorte d’extraordinaire élan exploratoire, une puissance d’accélération qui les arrache à leurs limites initiales. Ce n’est pas seulement le héros qui laisse derrière lui une mère furieuse et une femme séduite en s’enfonçant dans la montagne : c’est aussi toute la fiction qui se délivre des lourdeurs du « réalisme ». Comme une fusée atteignant la vitesse de libération entre dans le royaume où l’on flotte en apesanteur.
Peer Gynt est le poème de toutes les fuites et de tous les départs loin de la famille et du poids de ses origines, loin du mariage et de la charge de ses liens, loin de toute communauté tant chez les hommes que chez les trolls, loin de tout ce qui pourrait risquer de figer le mouvement librement erratique de cette naïve et folle ambition d’exister, de cette frénésie identitaire d’une vitalité si superbement insolente.
Qui donc est-il, ce Peer, et que vit-il ? Que se passe-t-il sur ce long chemin qui ramène de la mère à la compagne ? Ibsen a pris grand soin de ne pas apporter de réponse trop nette. Jamais l’orbite de l’existence gyntienne ne sera tout à fait refermée. « Dormir, rêver peut-être », disait Hamlet, songeant à la mort ; « Dors et rêve, mon garçon », dit Solvejg à Peer qui commence peut-être à vivre. Mais s’il ne meurt pas, lui, Peer-le-mythique, il n’en est au fond que plus mortel. Car dans cette pièce de tous les possibles où les destins semblent autant de masques qui ne demandent qu’à être décrochés, où tous les recoins de l’existence s’offrent à l’appétit du héros, où le fantastique se déploie en toute liberté, il est une loi qui jamais n’est suspendue. Peer a vieilli. Le temps avance, la mort approche et le néant qui se tient là en embuscade, et la jeunesse qui ne viendra plus.
Qu’est-ce donc qu’« être soi-même » ? Au terme de sa course, peut-être que Peer ne le sait pas. Et s’il décortique sa vie couche après couche, rôle après rôle, comme on pèle un oignon (ainsi qu’il le fait dans un monologue célèbre), son noyau substantiel paraît sans doute se réduire à rien. Pourtant, il n’a pas d’autre existence que celle-là. Et il n’en veut pas d’autre à déposer aux pieds de la femme qui attendait. Peu importe que l’au-delà soit païen ou chrétien : lui, Peer, refuse d’être pilonné, refondu, remis à la masse et à l’anonymat. Peer n’est pas encore mort. Il exige encore et toujours d’être reconnu singulier, maître et auteur de sa biographie, il exige de signer le matériau qu’aura été sa vie, opposant à tout créateur son droit inaliénable de créature : celui d’avoir laissé une marque sur la peau trop lisse du temps.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Odéon - Théâtre de l'Europe
Odéon - Théâtre de l'Europe
Place de l'Odéon 75006 Paris
- Métro : Odéon à 284 m
- RER : Luxembourg à 472 m
- Bus : Théâtre de l'Odéon à 29 m, Sénat à 90 m, Saint-Germain - Odéon à 229 m, Luxembourg à 252 m
Plan d’accès - Odéon - Théâtre de l'Europe
Place de l'Odéon 75006 Paris