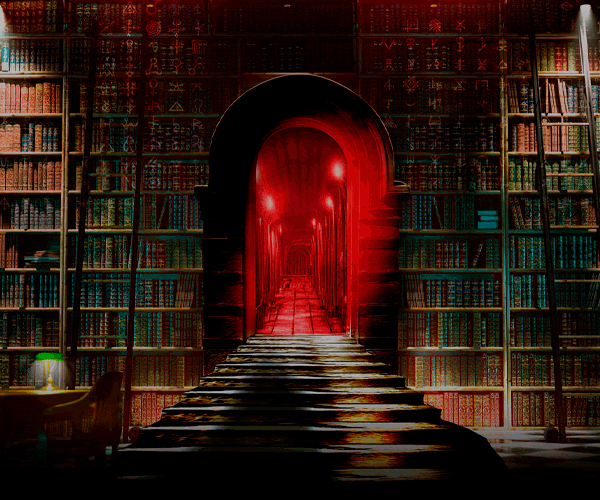Une petite douleur
Une petite douleur
- De : Harold Pinter
- Mise en scène : Claudia Morin
- Avec : Claudia Morin, Jean-Gabriel Nordmann, Alain Roland
Jeu d’esprit brillant et étrange
Harold Pinter, militant de la cause de l'homme
La traduction
Par une somptueuse matinée d’été toute imprégnée des odeurs de fleurs, Edouard et Flora prennent leur petit déjeuner. C’est le premier jour de l’été et tout semble devoir être agréable et heureux. Pourtant une guêpe intruse se glisse dans le pot de confiture. Il faut la tuer... cette belle journée commence par un meurtre.
Une angoisse, d’abord sourde, puis de plus en plus violente, assaille Edouard. Une petite douleur à l’oeil sans conséquence semble la déclencher. Mais non, ce n’est pas ce petit bobo qui le préoccupe mais bien la présence d’un marchand d’allumettes qui se tient depuis des semaines derrière la grille arrière de son jardin. Qui est-il ? Que vient-il faire là ? Pourquoi vend-il des allumettes sur un chemin que personne n’emprunte ?
Le marchand devient le support de toutes les angoisses refoulées d’Edouard qui l’observe avec terreur de la fenêtre de la maison donnant sur l’arrière du jardin. Il faut tirer cela au clair, le faire venir et lui parler. Mais l’homme se tait, Edouard ne tirera de lui que rire et larmes.
Harold Pinter, d’une situation quotidienne et banale, crée un univers singulier à la fois comique et étrange. La logique d’Edouard dérape face au mutisme du vieil homme. Point d’issue pour cet intellectuel enfermé dans son monde clos et cadenassé. Flora, l’épouse fidèle, quant à elle, se livre à une divagation amoureuse. Les vêtements boueux du marchand ne lui rappelle-t-il pas le viol dont adolescente elle a été victime ? Mais sans doute ce souvenir est-il excitant à raconter à l’inconnu ?
Harold Pinter nous engage sur des pistes, toutes vraisemblables. Il nous donne des indices comme s’il s’agissait d’un roman policier. Aucun ne nous mènera vers une compréhension claire de ce qui advient à ce couple qui nous ressemble tant. Le mystère et le questionnement nous tiennent en éveil pendant toute la pièce.
C’est à un jeu d’esprit brillant et étrange que l’auteur nous convie. Mêlant l’absurde, l’humour et le sentiment du tragique de l’existence, Harold Pinter mène sans faille cette Petite Douleur jusqu’à sa conclusion imprévisible.
Claudia Morin
Prix Nobel de littérature, 13 octobre 2005.
Depuis sa première pièce, en 1957, Harold Pinter s’est imposé au premier rang des dramaturges anglais, et sa notoriété s’est étendue au monde entier. Il a écrit plus d’une trentaine de pièces, qui marquent une extraordinaire constance dans son évolution créatrice. Elles englobent toutes les mêmes ingrédients de base : l’absurde, l’humour, l’affrontement dominant-dominé, l’économie d’un langage étincelant, tantôt picaresque, tantôt lyrique… et, surtout, la dénonciation (feutrée au début, véhémente depuis une dizaine d’années) des totalitarismes, qu’ils soient domestiques ou planétaires, intellectuels, sociaux ou politiques, qui broient l’homme sous le poids de périls connus ou insidieux.
Dans sa vie comme dans son oeuvre, Pinter est depuis toujours un militant de la cause de l’homme. L’écrivain et le citoyen ne font qu’un. Graduellement, le ton s’est fait plus grave, plus urgent,même si affleurent toujours le rire, la jubilation des mots, et un jeu de bascule vertigineux entre réalisme et abstraction. On en verra la preuve dans ses toutes dernières oeuvres, des brûlots politiques et libertaires qui, sous le masque des jeux du théâtre, traquent les tortionnaires, sous quelques cieux qu’ils opèrent.
Eric Kahane (La lune se couche, NRF Gallimard 1998)
Édouard : « Il est comme de la gelée. Une grosse masse de gelée de graisse de boeuf. Je suis certain qu’il a un oeil de verre… Il est à moitié sourd. À moitié, pas tout à fait. C’est presque un mort vivant. Pourquoi devrait-il me faire peur ? Non, tu n’es qu’une femme, tu ne sais rien. »
La découverte en France de l’oeuvre de Pinter, au début des années 60, est indissociable du travail de son traducteur français, Éric Kahane. Aujourd’hui cependant, ce ne sont pas les traductions de Kahane qui ont vieilli mais notre attente en matière de théâtre du « verbe » qui a changé. Retraduire Une Petite Douleur, c’est oser chercher le « petit bobo » (avec toute l’ambivalence moderne de ce mot) qui se cache derrière le titre anglais (A slight Ache). Les registres de langue ont évolué : les petits bourgeois anglais, s’ils continuent à distiller la même indifférence au monde (ils n’ont certes pas le monopole de cette attitude) perçoivent le monde à travers la langue de leur contemporain.
Qu’on le veuille ou non, la traduction d’un texte dramatique reste un acte s’inscrivant dans un contexte historique et culturel précis, ce qui n’est pas le cas pour le texte original qui est avant tout transcendance artistique.
Le souci de la bienséance dramatique a subi quelques modifications essentielles, surtout dans le domaine de cette prose poétique du quotidien intimement au travail dans les textes de Pinter. Les mots de Pinter, s’ils n’ont pas changé, résonnent d’une toute autre manière et la traduction travaille à partir de cette résonance, résonance chez le traducteur, chez les spectateurs français.
En 1958, Pinter imagine cet étrange couple qui, au fil de scènes de la Petite Douleur, va inscrire ses gestes, ses silences et ses paroles dans la mise en scène banalement destructrice d’un monde qui se libère (se libéralise ?) dans l’horreur. On a beau chercher, il existe peu de paroles équivalentes sur nos scènes de théâtre européennes, et ce n’est que rendre justice à ce texte que de lui donner, par le truchement toujours maladroit d’une nouvelle traduction, la force et l’évidence d’une parole que nous nous devons de recevoir dans sa plus radicale modernité.
René Fix
Une petite douleur – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Mouffetard
Mouffetard
73, rue Mouffetard 75005 Paris