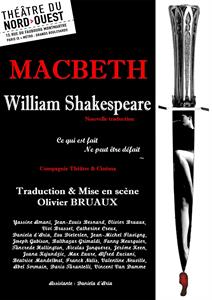Othello
Othello
- Une machination diabolique
Parce qu'il a vaincu les Turcs dans la guerre qui les opposait à la république de Venise, Othello, bien que maure, peut enfin vivre son mariage avec la belle Desdémone.
Homme exceptionnel, paré de toutes les vertus, rien ne compromet son bonheur, rien, sinon la haine féroce que lui voue secrètement son officier Iago. Ce dernier, profitant du caractère jaloux et impétueux d’Othello, échafaude une machination diabolique qui va faire croire à ce dernier que Desdémone le trompe avec le lieutenant Cassio.
À la vue de ce qu’il prend pour la preuve ultime de l’infidélité de sa femme - un mouchoir dans les mains de son prétendu rival -, Othello va commettre l’irréparable, avant qu’on ne lui dévoile sa terrible méprise. Il n’a plus alors d’autre issue que de se tuer sur le corps de Desdémone.
Pour elle, Othello n’est pas seulement une tragédie sur la manipulation et la jalousie ; elle est plus essentiellement une dissection de l’âme humaine, malade, une interrogation sur cette effroyable aptitude qu’ont les hommes pour la haine de l’autre.
Texte français de Norman Chaurette.
- Une œuvre de maturité
William Shakespeare écrit Othello vers 1604, en s’appuyant sur la nouvelle de Gianbattista Giraldi Cinthio, Un capitano moro, publiée en 1565 en Italie. En 1603, après le couronnement du roi Jacques Ier, la troupe de Shakespeare, à son apogée, devient « The King’s Men », la troupe du nouveau monarque. Elle réside au Globe, théâtre le plus prisé de Londres. Écrit entre Mesure pour mesure et Le Roi Lear, Othello est une œuvre de maturité. Sept ans après la création de la pièce, Shakespeare se retire dans sa propriété de Stratford-upon-Avon, sa ville natale, en 1611 ; il y meurt en 1616, à 52 ans.
- Notes d'intention de mise en scène
L'oeuvre « simple » de Shakespeare
De toutes les tragédies écrites par Shakespeare entre 1599 et 1608 – parmi lesquelles on compte Jules César, Hamlet, Le Roi Lear, Macbeth, Antoine et Cléopâtre, Coriolan, Timon d’Athènes –, Othello (écrite entre Hamlet et Le Roi Lear) est peut-être la plus simple, la moins baroque, la moins hétérogène, la moins « cosmogonique ». On n'y trouve ni profusion stylistique ni accumulation d'intrigues. C’est aussi pourquoi il n’y a en elle ni échappatoire, ni répit. Cela en fait une pièce unique dans l'oeuvre de Shakespeare. Unique aussi, hier comme aujourd’hui, parce qu’elle raconte l’histoire d’un Noir. Un Noir en Occident, un immigré, un apatride.
Pour moi, elle offre une sorte de pendant au Marchand de Venise, à ceci près que Le Marchand de Venise conserve encore une structure plurielle : s’il pointe ce qu’on appelle de nos jours l’antisémitisme, la xénophobie, la cristallisation de la haine et de la violence autour des différences raciales ou pseudo-raciales, il subsiste encore la possibilité de l’amour, de l'intelligence ; il y a une issue, à l’inverse d’Othello.
Ce Noir, c'est ce que Malcolm X appellera plus tard un Oncle Tom : un Noir qui croit être « intégré » ou qui veut l'être. Qu'il le soit ou non importe peu : d'avance, par essence, il est perdant. Lui qui, même fier, même grand, a intégré et accepté l'idée qu'il lui faudra mériter sa place, en faire plus pour être à égalité avec les autres, gommer son infériorité. Shakespeare en 1604 raconte l’histoire d’un homme, de cet homme-là. Sans militantisme et sans démonstration mais par l'épaisseur et la vérité de ses personnages, Shakespeare nous montre comment, dans une ville qui concentre le pouvoir et la puissance, un métèque qui a gravi tous les échelons de la carrière militaire, qui a servi sa république et en fréquente les édiles, tombe amoureux d'une femme blanche, qui l'aime en retour. Et tout est réaliste, précis. Il montre aussi un père, un amant éconduit et un certain Iago qui n'admettent pas ce fait, cet amour – reflétant par là l’état de l’opinion moyenne de l'époque, qui n’est en somme pas très éloigné du nôtre.
L'étranger aux prises avec le mal absolu
La pièce s’ouvre sur une menace : un « méchant » parle, jalouse, dénigre. Puis c'est la beauté. Tout le premier acte montre le calme et l'intelligence d'Othello, l'amour total d'une Desdémone incandescente et grave. Bien évidemment, le spectateur entre en empathie avec ce couple qui, une demi-heure plus tôt, pouvait encore lui paraître « contre-nature ». Tout comme le Doge et ses ministres, qui ont intérêt à ne pas condamner Othello et à le laisser gagner Chypre, mais qui semblent aussi approuver cette alliance folle. Un processus d’émancipation a eu lieu, sur scène et dans la salle.
À ce stade de la pièce, il ne fait guère de doute que le Bien, l'espoir, l'amour l'emporteront sur l'envie et la haine. Pourtant, le reste de la pièce ne sera qu'une lente descente aux enfers, implacable. Et jamais l'espoir n'aura plus la moindre chance. Je me suis demandé d’où venait le suspense de la pièce puisque cette structure est très vite apparente. Iago annonce ce qu'il va faire, le mal est dit puis il est fait, inexorablement. D’où vient alors cette tension terrible ? Du public, de la résistance que provoque en nous cette progression inouïe du Mal. Elle vient du rapport qui s’instaure entre la pureté du Mal et nous. À chaque étape, on se dit que le méchant va s’arrêter, ou qu'il va être démasqué. On ne peut, on ne veut pas y croire. On lutte, on tremble, on rit aussi ; car le rire n’est pas toujours joyeux. Cela ne s’arrêtera que lorsque tous auront été torturés, torturés à mort.
Le mal est parfait. Il n'est pas anodin que ce soit un étranger, un apatride, un immigré à qui tout cela arrive. Et il n'est pas anodin que ce soit un Noir, un être dont on croit voir à sa peau qu'il est le Maudit. Othello finira effectivement par s'abandonner à l'image qu'on a de lui, une image qu'il craignait qu'on ait de lui depuis toujours et pour toujours : « Je suis une bête, je suis capable de broyer de mes mains, je ne comprends rien, je ne suis que force, je ne suis qu’instinct… » C’est aussi cela qui déchire, le voir comme un lion pris au piège, s’écorchant vif lui-même. Je ne suis pas sûre qu'il soit possible à tout le monde, aux « épargnés », de vraiment « savoir » ce que signifie être ainsi méprisé, craint, tué, brûlé, effacé de la surface de la terre à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion. Mais je pense aussi que l'intelligence humaine, l'art, les oeuvres, peuvent permettre de « comprendre », de « prendre avec soi », de partager. Et de progresser, peut-être. Cette pièce est porteuse d’un enseignement fort sur l'Humanité, qu’elle traite avec une intelligence pure, presque violente.
Couloir, ruelle, forteresse
Au Théâtre du Vieux-Colombier, tout décor doit tenir compte de la contrainte qu'impose la salle, tout en longueur, sorte de navire renversé. J'ai choisi d'accentuer l'effet de tunnel, de trouver une correspondance scénographique, dans le premier acte, entre ce couloir et la topologie de Venise, une ville de ruelles, de canaux, de voies sans issue, de petites places closes. Nous avons imaginé, avec le scénographe Massimo Troncanetti, un tracé qui clôt l’espace et avons construit une étroite ruelle, plongée dans l'ombre.
Un deuxième décor présente ensuite, à l'intérieur du palais du Doge, un bureau tout coffré de bois et assez exigu, en référence aux bureaux où travaillait le Doge et où se prenaient toutes les décisions importantes et secrètes. C'est de là que le Doge enverra à Chypre Othello, seul général capable de vaincre les Turcs et de protéger l'empire vénitien.
Pour Chypre, lointaine île méditerranéenne, forteresse située à la frontière du monde sauvage, nous avons imaginé un espace assez carcéral où de hauts murs enserrent une cour de terre battue. La mer, déchaînée au début du deuxième acte, vient s'écraser contre ces murailles. Les acteurs iront souvent la voir, juchés sur le bord de grandes fenêtres donnant sur l'à-pic, comme autant de meurtrières géantes.
Un dispositif scénographique clos à l’intérieur duquel Shakespeare montre la dislocation, la putréfaction d’un monde où se confrontent un élément « extérieur » qui se croit intégré – Othello – et un élément « interne » fondamentalement corrompu – Iago.
Mélanger les époques, sans que cela ne se voie
J’ai toujours réalisé les costumes des spectacles que j’ai mis en scène, un travail qui me semble être le prolongement naturel de la direction d'acteur. Quand il s'agit de textes contemporains, je demande parfois aux comédiens d'utiliser des vêtements qui leur appartiennent. Un pull que la peau reconnaît suffit parfois pour que l'acteur « fasse corps » avec son personnage… Ce fut le cas avec Andrzej Seweryn et Laurent Natrella lorsque j’ai monté Pour un oui pour un non de Nathalie Sarraute au Studio-Théâtre.
La tâche est plus complexe quand il s'agit de textes anciens. Si le mélange d’éléments historiques et modernes dans les costumes est devenu courant, il pose à mon avis problème parce qu'il est souvent trop démonstratif et ne suffit pas à « rapprocher » une oeuvre classique d’un public contemporain. Le mélange esthétique doit rester invisible. Je voudrais que les silhouettes d'Othello nous soient « familières », qu'elles n'aient rien de spectaculaires, au sens propre du terme. Une ligne simple, des drapés, des couleurs sombres, autant de figures proches de celles que notre oeil connaît parce qu’il les a vues à la fois dans les oeuvres de Léonard de Vinci ou de Raphaël et dans celles d’Antoine Vitez ou de Pina Bausch. Un certain classicisme en somme, au sens où ce qui est vraiment classique est toujours et résolument moderne. Nous avons de plus à la Comédie-Française la chance extraordinaire de disposer d'un stock de costumes, de bijoux, d'accessoires, traces de tous nos spectacles passés qui sont le fruit du travail de tant de corps de métiers différents. J'ai voulu aussi faire vivre ce trésor. Je trouve très émouvant de voir, de porter le costume d'un grand acteur, d'une grande actrice, et de convoquer par là son fantôme et tous les esprits bénéfiques du théâtre...
Un rapport au sacré
Lorsque j’ai commencé à penser à la distribution, Bakary Sangaré en Othello a été pour moi une évidence, comme inspirée par la démarche de Peter Brook et de son travail avec les acteurs étrangers, balinais, japonais ou africains. Je trouve ses propos très clairs, lumineux. À l’époque où il montait La Tempête, il précisait qu’il s’agit d’une pièce métaphysique, que l’oeuvre de Shakespeare est profondément spirituelle mais que l’on a aujourd’hui une peur bleue de ces termes, ce qui nous pousse à vouloir trouver « autre chose » dans Shakespeare.
C’est cette « réalité » de la pièce qu’il cherche à faire apparaître et il différencie en ce sens deux types d’acteurs : même en ayant une intuition spirituelle forte, quelqu’un qui est né et a grandi dans une ville occidentale est inévitablement marqué par son éducation strictement rationaliste tandis qu’un autre, issu d’une éducation et une culture traditionnelles – sans rupture entre le monde visible et le monde invisible –, aura et donnera un accès « direct » aux sources d'où viennent les actions et les images des pièces de Shakespeare.
Au-delà de l’identité artistique profonde et singulière de chacun des comédiens de cette distribution, je désirais retrouver cette dimension dans Othello. L’acteur malien Bakary Sangaré nous fait justement entendre différemment la musique du texte. Face à notre génération post-nietzschéenne, il semble que « Dieu ne soit pas mort » pour lui. Je trouvais intéressant de voir comment fonctionne cet antagonisme dans Othello, comment chacun est ou n’est pas « contaminé » par l'autre. Un homme arrive et dit en substance : mes mots ne sont pas les vôtres, mais je vais essayer de m’expliquer clairement, même si cela m’est difficile... Et il se lance dans un monologue sublime, dans cette langue de Shakespeare où l’on comprend tant de choses, mais qui nous résiste aussi. Cette part de mystère, il faut l'accepter. Et l’interprète qu’est Bakary Sangaré la porte naturellement en lui.
Léonie Simaga, mars 2014
Propos recueillis par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Vieux Colombier - Comédie-Française
Vieux Colombier - Comédie-Française
21 rue du Vieux-Colombier 75006 Paris
- Métro : Saint-Sulpice à 61 m, Sèvres - Babylone à 258 m
- Bus : Michel Debré à 23 m, Sèvres - Babylone à 189 m, Saint-Germain-des-Prés à 231 m, Musée du Luxembourg à 349 m
Plan d’accès - Vieux Colombier - Comédie-Française
21 rue du Vieux-Colombier 75006 Paris